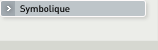|
Le chemin des Cathédrales / Raison et foi /Le débat intellectuel
| Le débat intellectuel Le Moyen Age a été préoccupé par le retour du raisonnement logique, au point de s’attacher à une question que les croyants n’avaient jamais posée dans ces termes: “la raison s’oppose-t-elle à la foi?” De cette exigence intellectuelle est née l’Université. | |||||||||||||||
Présupposés théologiques : | |||||||||||||||
Le débat foi et raison entre les savants juifs, musulmans et chrétiens. Les Juifs connaissaient les même dilemmes: abandonner leurs intellectuels à la révolte contre la Bible, ou bien rendre accessible à la raison la justification de la foi. Maïmonide tentera de résoudre cette antinomie en soulignant l’initiative du Créateur qui manifeste son existence par la création. En étudiant la nature pour elle-même dans un esprit qui inaugure les interrogations scientifiques ultérieures, ce philosophe offre un rôle à la raison. Il montre que Dieu conduit aussi les hommes à la connaissance de son œuvre par sa manifestation dans l’histoire et l’explication qu’en offre la parole des prophètes. Cette étude des invasions et des déportations successives qui n’ont pas entravé la permanence du peuple élu au sein de l’Antiquité manifeste aux yeux de Maïmonide une initiative surnaturelle, confondante pour l’exigence rationnelle interpellée par les textes sacrés: on peut lire ceux-ci en s’émerveillant de leur sens, mais à la raison qui doute d’eux Maïmonide répond par l’histoire. Le peuple auquel sont adressés ces textes traverse toutes les adversités qui auraient dû le détruire. Les découvertes scientifiques comme l’algèbre, l’inventions des nouvelles techniques, architecturales venues de la société musulmane d’Andalousie se doublaient des études des textes des philosophes grecs égarés pendant les grandes invasions. L’intérêt immédiat des apports musulmans les avait fait accepter sans problèmes par la Chrétienté naissante, il en allait tout autrement du renouvellement des problématiques philosophiques consécutives aux traductions du grec en arabe et de l’arabe en latin. Certains théologiens étaient tentés de refuser tout contact avec cette pensée nouvelle. Au sein de ces appréhensions, certains maîtres comme Hugues de Saint-Victor, saint Albert le Grand, saint Thomas d’Aquin se refusèrent à condamner sans appel les découvertes qui venaient du sud de l’Europe. S’appuyant sur les écrits de Denys l’Aréopagite qui développe la conviction que Dieu est lumière, ils enseignaient que, convenablement approchée, la révélation sert la vérité, même toute humaine, parce que la vérité ne se contredit pas, quel que soit le chercheur qui la trouve. De la sorte ces savants ne méprisaient pas ceux qui cherchaient comme eux, Juifs ou Musulmans, et étaient même prêts à épouser les fruits de leurs travail quand ils sont compatibles avec le chemin qu’ils suivaient à la lumière de l’Evangile. S’informant des traductions des Juifs et des Musulmans de Tolède, ils les citaient soit pour conforter leur propre enseignement, soit pour les réfuter par une discussion logique et scientifique sans pour autant recourir à l’autorité pour les condamner. Il arrive aujourd’hui encore que des étudiants se sentent associés à la recherche de leur professeur, mais ce n’est pas la règle générale. La communauté d’intérêt entre le maître et ses disciples a marqué si profondément le Moyen Age, que les élèves pouvaient suivre leur professeur de ville en ville et qu’ils constituaient un corps si particulier dans la société, qu’il échappa rapidement aux pouvoirs locaux pour être immédiatement rattaché à la papauté. Ce fut la naissance de l’Université. | |||||||||||||||
| haut de la page | |||||||||||||||
| |||||||||||||||