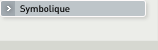|
Le chemin des Cathédrales / Raison et foi /Le rôle de l’intelligence
| Le rôle de l’intelligence L’intelligence de l’homme peut-elle prétendre à concevoir qui est Dieu? Si oui, comment une telle intimité entre le Créateur éternel et sa créature mortelle est-elle possible? | |||||||||||||
| |||||||||||||
Averroès Averroès, discours décisif, trad. Marc Geoffroy, introduction Alain de Libera, Paris: GF 1996 34. On peut quasiment dire : ceux qui s’opposent sur ces questions extrêmement ardues, soit sont dans le vrai, et dans ce cas ils seront récompensés; soit se trompent, et alors ils seront pardonnés (1). Car le fait d’assentir à quelque chose par l’effet d’une preuve établie dans son esprit est un acte contraint et non libre, c’est-à-dire qu’il n’est pas en notre pouvoir d’assentir ou non de la même façon qu’il est en notre pouvoir de nous mettre ou non debout. Aussi, comme une condition de la responsabilité légale (2) est le libre arbitre, celui qui donne son assentiment à une proposition erronée parce que quelque incertitude l’a affecté, s’il est homme de la science, est pardonnable. C’est pourquoi le Prophète - sur lui soit la paix - a dit : “Qu’un juge produise un effort de jugement personnel et tombe juste, il sera doublement récompensé. Qu’il se trompe, il aura une récompense [simple].” Or y a-t-il juge plus éminent que celui qui juge que l’être est tel plutôt que tel? Ces juges-là, ce sont les savants auxquels Dieu a réservé - et à eux seuls - le droit d’interpréter; et cette erreur dont la Loi stipule qu’elle est pardonnable, c’est celle qui peut être le fait des savants lorsqu’ils examinent les questions extrêmement ardues que la Révélation les a engagés à examiner. 35. Par contre, l’erreur commise par ceux qui n’appartiennent pas à cette classe d’hommes, elle, n’est que pur péché, que ce soit dans des questions théoriques ou bien pratiques : de même qu’un juge ignorant de la Tradition prophétique n’est pas pardonnable s’il rend un jugement erroné, de même celui qui juge sur les étants, s’il ne réunit pas les conditions habilitant à juger, n’est pas pardonnable, mais au contraire est soit pécheur, soit infidèle. Si d’une personne qui juge de la licéité ou de l’illicéité [des choses] on exige qu’elle rassemble les conditions [légales] habilitant à pratiquer l’effort interprétatif, c’est-à-dire la connaissance des Sources [du Droit], et la connaissance des procédures de déduction à partir de ces Sources au moyen du raisonnement analogique, combien la même chose doit être a fortiori exigible de celui qui juge sur les étants, à savoir qu’il connaisse les principes premiers rationnels et la manière d’en déduire [des conclusions] ! 36. En somme, il existe deux sortes d’erreur du point de vue de la Loi: l’erreur pardonnable lorsqu’elle est le fait d’hommes aptes à pratiquer l’examen rationnel dans le domaine où l’erreur a été produite (comme on pardonne au médecin expérimenté de s’être trompé dans l’art de la médecine, ou au juge expérimenté de s’être trompé dans un jugement), et impardonnable si elle provient de quelqu’un qui n’est pas de la partie; et l’erreur impardonnable de qui qu’elle vienne, et qui, si elle touche les principes [dogmatiques] fondamentaux de la Loi révélée , est infidélité ou, si elle touche quelque chose en deçà de ces principes fondamentaux, est une innovation blâmable. Cette sorte d’erreur est celle commise à propos de choses à la connaissance desquelles l’ensemble des méthodes d’argumentation aboutissent [également], et qu’il est de la sorte possible à tout le monde de connaître. | |||||||||||||
| haut de la page | |||||||||||||
Averroès Commentaire sur le De Anima, livre III d’Aristote (dans L’intelligence et la pensée, par Alain de Libéra et Marc Geoffroy, éd. GF Flammarion, Paris, 1998) La question difficile du mécanisme de l’intelligence a été longuement étudiée par Averrèos qui la résume ainsiö: Mais pour nous, qui avons posé que l’intellect matériel est éternel, que les intelligibles théoriques sont engendrables et corruptibles selon le mode que nous avons dit, et que l’intellect matériel pense et les formes matérielles et les formes séparées, il est manifeste que, selon ce mode, le sujet des intelligibles théoriques et de l’intellect agent est unique et identique, à savoir l’[intellect] matériel. Et [l’on peut illustrer] cela par une comparaison avec le diaphane, qui reçoit simultanément la couleur et la lumière - la lumière étant ce qui actualise [efficiens] la couleur. Une fois la jonction de l’intellect agent et de l’intellect matériel ainsi vérifiée (verificata) pour nous, nous pouvons assigner (reperire) le mode selon lequel nous disons que l’intellect agent est semblable à une forme et l’intellect en habitus, semblable à une matière. En effet, pour toutes les choses dont le sujet est un, mais dont l’une est plus parfaite que l’autre, le rapport du plus parfait au plus imparfait est nécessairement comme le rapport de la forme à la matière. C’est en ce sens que nous disons que le rapport de la perfection première de la faculté imaginative à la perfection première du sens commun est comme celui de la forme à la matière. Par là même, nous obtenons le mode selon lequel cet intellect peut se joindre à nous à la fin, et la cause pour laquelle il ne nous est pas uni au commencement. Parce que, de ce que nous venons de poser découle nécessairement que l’intellect qui est en nous en acte est composé des intelligibles théoriques et de l’intellect agent de façon telle que l’intellect agent soit comme la forme des intelligibles théoriques et que les intelligibles théoriques soient comme une matière. Et c’est grâce à ce mode que nous pouvons engendrer des intelligibles à volonté. Car, puisque ce par quoi quelque chose effectue son action propre est la forme, et que nous effectuons par l’intellect agent notre (nostram) action propre, il faut nécessairement que l’intellect agent soit pour nous forme. Or, il n’y a pas d’autre mode de génération de [cette] forme pour l’homme (in nobis), que ce mode-là. Car puisque les intelligibles théoriques nous sont unis par les formes imaginaires, et que l’intellect agent est lui-même uni aux intelligibles théoriques (du fait que ce qui les perçoit est le même [sujet], à savoir l’intellect matériel), il est nécessaire que l’intellect agent nous soit uni par sa jonction avec les intelligibles théoriques. Et il est manifeste que, quand tous les intelligibles théoriques existent en nous en puissance, il nous est uni en puissance, que quand tous les intelligibles théoriques existent en nous en acte, il nous est uni en acte et que, quand certains nous sont unis en puissance et d’autres en acte, il nous est uni selon une partie, et selon une autre partie, non. On dit alors que nous nous mouvons vers la jonction. Et il est manifeste que quand ce mouvement est achevé, l’intellect [agent] s’unit aussitôt à nous sur tous les modes. Et il est manifeste qu’alors, dans cet état [qu’est la jonction], le rapport de l’intellect [agent] à l’homme est comme le rapport de l’intellect en habitus à l’homme. Et lorsqu’il en est ainsi [que cette jonction avec l’intellect agent est accomplie], il est nécessaire que [par cet intellect], l’homme pense tous les êtres par un intellect qui lui est propre et effectue sur tous les êtres l’action qui lui est propre [qui est de les penser], de la même manière que, par l’intellect en habitus il pensait tous les êtres par une intellection qui lui était propre, quand [son intellect] était joint aux formes imaginables. Selon ce mode, l’homme est donc, comme le dit Thémistius, semblable à Dieu, car il est d’une certaine manière tous les êtres et il les connaît [tous] en quelque manière; en effet, les êtres ne sont rien d’autre que sa science, et la cause des êtres n’est rien d’autre que sa science. Et que cet ordre est admirable! Que ce mode d’être est extraordinaire. Ce mode vérifie aussi l’opinion d’Alexandre selon laquelle l’intellection des choses séparées se fait par la jonction de cet intellect avec nous, non au sens où l’acte de pensée existerait en nous alors qu’auparavant il n’existait pas ce qui est la cause de la jonction de l’intellect agent avec nous, telle que l’entendait Avempace, mais au sens où c’est la jonction qui est la cause de l’intellection, et non l’inverse. | |||||||||||||
| haut de la page | |||||||||||||
Thomas d’Aquin (XIIIe siècle), faut-il admettre l’existence d’un intellect agent? Somme théologique. I-II, question 79, art.3 En sens contraire, le Philosophe (Ibid. V 1 (430 a 10)) affirme: “comme en toute nature, il y a dans l’âme un principe par lequel elle peut devenir toutes choses, et un principe par lequel elle peut les faire.” Il faut donc reconnaître l’existence d’un intellect agent. Réponse: Selon Platon, un intellect agent n’était nullement nécessaire pour rendre l’objet intelligible en acte; seulement peut-être pour donner la lumière intellectuelle à celui qui pense comme on le dira plus loin (a. 4; Q. 84, a. 6). Platon affirmait en effet que les formes des réalités naturelles subsistent sans matière, et par conséquent qu’elles sont intelligibles en acte, car cela dépend de l’immatérialité. Ces formes, il les appelait “idées”. Et c’est, d’après lui, par une participation à ces idées que d’une part la matière des corps est informée, ce qui donne aux individus d’exister dans leurs genres et espèces ; et de l’autre, nos intelligences, ce qui leur donne de connaître les genres et les espèces des choses. Mais Aristote (Cf. II Metaph. IV 6 (999 b 18)) n’admettait pas que les formes des réalités physiques puissent subsister sans matière. Par conséquent, les formes des choses sensibles que nous connaissons ne sont pas actuellement intelligibles. Or rien ne passe de la puissance à l’acte sinon par un être en acte, tel le sens par rapport au sensible. Il fallait donc supposer dans l’intelligence une faculté qui puisse mettre en acte les objets intelligibles, en abstrayant les idées des conditions de la matière. D’où la nécessité de l’intellect agent. Solutions : 1. Les objets sensibles sont en acte hors de l’âme; il n’est donc pas besoin de supposer un sens agent. En somme, toutes les puissances végétatives sont actives; toutes les puissances sensibles sont passives; mais dans l’intelligence, y a un principe actif et un principe passif. 2. Il y a deux opinions sur le rôle de la lumière. Selon les uns, la vue requiert la lumière pour que les couleurs soient visibles en acte. Parallèlement, l’intellect agent est requis dans l’intellection pour accomplir la même fonction que la lumière dans l’acte de voir. Selon d’autres, il faut la lumière non pour rendre visibles les couleurs, mais pour rendre le “ milieu ” lumineux en acte. C’est l’opinion d’Averroès, dans son commentaire du traité de l’Ame. En ce sens, l’analogie aristotélicienne de l’intellect agent avec la lumière doit se comprendre ainsi: l’un est nécessaire pour l’intellection comme l’autre pour la vision, mais non avec un rôle identique. | |||||||||||||
| haut de la page | |||||||||||||
Thomas d’Aquin (XIIIe siècle) Somme théologique. I-II, question 79, art.3 En sens contraire, il y a le même rapport, selon Aristote (II Phys. 111 12 (195 b 26)), entre les causes universelles et leur effet universel, et entre les causes particulières et leur effet particulier. Or il est impossible qu’une âme, unique dans son espèce, appartienne à des êtres vivants d’espèces différentes. Il est donc impossible qu’une âme intellectuelle, unique numériquement, appartienne à divers êtres particuliers. Réponse: Que l’intelligence soit unique pour tous les hommes, c’est absolument impossible. Et cela est évident, d’abord dans la position platonicienne, où l’on admet que l’homme, c’est l’intelligence. Si Socrate et Platon ne sont qu’un seul intellect, ils forment un seul homme, et ne se distinguent l’un de l’autre que par les éléments surajoutés à leur essence. Il n’y aurait pas plus de différence entre Socrate et Platon qu’entre l’homme vêtu d’une tunique, et le même homme vêtu d’une pèlerine, ce qui est parfaitement absurde. C’est encore évident avec la position aristotélicienne, où l’intelligence est une partie, une faculté de l’âme qui est la forme du corps. Il est impossible qu’il n’y ait qu’une forme pour plusieurs réalités numériquement distinctes; tout autant qu’il est impossible qu’elles aient un seul être. Car le principe de l’être, c’est la forme. ... Mon acte intellectuel pourrait se distinguer du vôtre en raison de la distinction de nos images, car l’image de la pierre en moi n’est pas la même que son image en vous. Mais il faudrait pour cela que l’image, pour autant qu’elle est propre à chacun de nous, fût la forme de l’intellect possible. Car le même être, agissant selon diverses formes, produit des actions diverses; de manière analogue, des formes diverses dans la réalité produisent dans un même œil plusieurs sensations visuelles. Or, la forme de l’intellect possible, ce n’est pas l’image, mais l’espèce intelligible abstraite des images. Une seule intelligence n’abstrait de diverses images de même espèce qu’une seule espèce intelligible. Aussi peut-il se trouver plusieurs images de la pierre dans une même conscience humaine, et cependant on n’en abstraira qu’une seule espèce intelligible de la pierre. Par elle, l’intelligence d’un seul homme comprend en un seul acte la nature de la pierre, malgré la multiplicité des images. Donc, en admettant qu’il n’y ait qu’une seule intelligence pour tous les hommes, la diversité des images en plusieurs individus ne pourrait causer la diversité des actes intellectuels en chacun d’eux, comme l’imagine le Commentateur, au livre III du traité De l’Âme. - Il est donc absolument impossible et inacceptable de n’admettre qu’une seule intelligence pour tous les hommes. | |||||||||||||
| haut de la page | |||||||||||||
Charles Péguy Présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres Charles Péguy a consacré ce poème à la cathédrale de Chartres qu’il voyait comme le signe de la prière des hommes à la fois pécheurs et croyants, qui trouvaient dans leur foi la force de s’adresser à la mère du Christ. “Un homme de chez nous, de la glèbe féconde A fait jaillir ici d’un seul enlèvement, Et d’une seule source et d’un seul portement, Vers votre assomption la flèche unique au monde. … Un homme de chez nous a fait jaillir, Depuis le ras du sol jusqu’au pied de la croix, Plus haut que tous les saints, plus haut que tous les rois, La flèche irréprochable et qui ne peut faillir.” | |||||||||||||
| haut de la page | |||||||||||||
| |||||||||||||